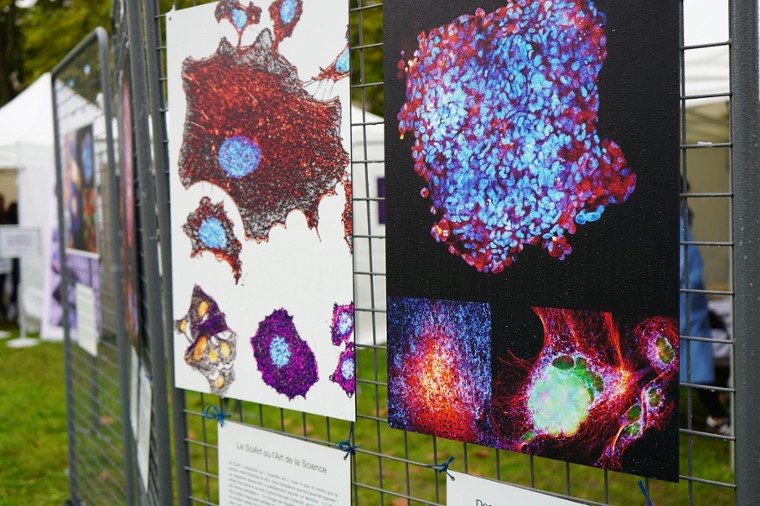Dans le cadre du mois du vrac et de la semaine des transitions, la question de la consommation durable est plus que jamais d’actualité. Élisa Monnot, enseignant-chercheur en marketing au laboratoire THEMA, a publié avec deux collaboratrices un article qui démontre que s’affranchir des emballages demande une véritable réflexion pour les distributeurs et les consommateurs.
L’article, intitulé
Packaging-free shopping: when retailers and consumers (re/mis) appropriate packaging functions (les achats en vrac : quand les distributeurs et les consommateurs se réapproprient ou détournent les fonctions des emballages) a été publié dans
Journal of Product & Brand Management en février 2025. Dans l’entretien suivant, Élisa Monnot nous en donne les clés.
Auteurs
- Fanny Reniou (Univ Rennes, CNRS, CREM – UMR 6211, Rennes, France)
- Élisa Robert-Monnot (CY Cergy Paris Université, CNRS, ThEMA, Cergy, France)
- Sarah Lasri (Universite Paris-Dauphine, Universite PSL, CNRS, DRM, Paris, France
Source de l’article
Reniou, F., Robert-Monnot, E., & Lasri, S. (2025). Packaging-free shopping: when retailers and consumers (re/mis) appropriate packaging functions.
Journal of Product & Brand Management, 34(2), 231-250.
Consulter l'article en accès libre sur HAL
CY Cergy Paris Université : Comment avez-vous été amenée à étudier le sujet des produits en vrac ?
Élisa Monnot : Le sujet des produits en vrac s’est imposé à nous comme une évidence ! En effet, cela faisait déjà plusieurs années que nous travaillions, avec ma collègue Fanny Reniou, sur la thématique de la réduction des emballages et du tri des déchets, d’emballages en particulier. Le redéploiement par les enseignes de ce mode de distribution et de consommation des produits, sans emballage donc, nous a donc conduites à nous y intéresser naturellement, afin d’essayer de mieux comprendre comment les consommateurs s’en emparaient. C’est aussi une histoire de rencontres, puisque nous avons eu la chance de mener cette recherche, qui s’inscrit dans le cadre d’un projet plus global, en partenariat avec une enseigne de distribution spécialisée.
CY Cergy Paris Université : Comment avez-vous mené cette étude et quelles sources de données avez-vous utilisées ?
Élisa Monnot : Cette recherche a été conduite en collaboration avec la société coopérative Biocoop, qui est assez pionnière en France sur le sujet du vrac et qui se posait, à ce moment-là aussi, début 2019, un certain nombre de questions sur comment encourager le vrac dans ses magasins. Nous avons donc construit ce projet de recherche avec elle. Nous avons utilisé une diversité de données : observations en magasin, prise de photographies, entretiens avec des responsables de magasin et de rayon vrac, entretiens avec des consommateurs, posts Instagram. Notre collègue, Sarah Lasri, nous a rejointes sur ce projet pour apporter son expertise sur l’analyse de données issues des réseaux sociaux.
CY Cergy Paris Université : Quel rôle l’emballage joue-t-il dans le choix des consommateurs ?
Élisa Monnot : La littérature s’intéresse depuis longtemps à l’emballage, ce "vendeur silencieux" généralement décisif dans la décision d’achat en magasin. Elle identifie un certain nombre de fonctions que cet emballage assure. Des fonctions logistiques, tout d’abord, de préservation, protection et stockage du produit, l’emballage pouvant permettre de limiter les chocs, par exemple lors du transport. Des fonctions marketing, ensuite, de reconnaissance de la catégorie de produit ou de la marque, par un choix de couleur spécifique par exemple, mais aussi d’attractivité en rayon si l’emballage est d’une forme particulière, une fonction de positionnement en véhiculant visuellement un niveau de gamme particulier, mais aussi une fonction d’information, l’emballage servant de support pour communiquer un certain nombre d’éléments (composition, date de péremption, labels, etc.). Enfin, des fonctions environnementales, liées au fait de limiter la taille de l’emballage et de privilégier certains types de matériaux (recyclés, recyclables). Le consommateur peut donc accorder plus ou moins d’importance à ces différentes fonctions et en privilégier certains par rapport à d’autres.
CY Cergy Paris Université : Quels sont les principaux défis auxquels sont confrontés les distributeurs et les consommateurs dans un modèle de vente en vrac ?
Élisa Monnot : Dans un modèle de vente en vrac, les distributeurs et consommateurs doivent s’adapter pour assurer la continuité de ces multiples fonctions qu’assure habituellement l’emballage. Dans la mesure où l’industriel ne propose plus un emballage prédéterminé pour ses produits, les distributeurs et consommateurs doivent s’approprier conjointement ces fonctions. Un des défis réside donc pour eux dans cette appropriation et dans la manière dont elle peut s’effectuer, correctement ou non.
CY Cergy Paris Université : Comment les consommateurs s’approprient-ils ce mode d’achat ?
Élisa Monnot : Dans cet article, ce que nous avons étudié est la manière dont les consommateurs, mais également les distributeurs, s’approprient, non pas ce mode d’achat qu’est le vrac, mais les fonctions de l’emballage, alors même que celui-ci n’est plus fourni par les industriels. Nous montrons que les acteurs doivent adopter de nouvelles manières d’assurer les fonctions de l’emballage et se les (ré)approprier. Nos résultats permettent d’identifier deux modes d’appropriation : par assimilation (quand les individus trouvent des moyens pour imiter les emballages typiques et leurs attributs) ou par accommodation (quand les individus imaginent de nouveaux emballages et développent de nouvelles compétences). Ainsi, par exemple, certains consommateurs réutilisent les emballages industriels, tels que les boîtes d'œufs et les bidons de lessive, qui ont fait leur preuve en matière de praticité pour se servir, protéger le produit ou le transporter facilement. Mais les individus peuvent également décider de procéder autrement : les emballages ne sont alors plus le reflet d’une marque mais celui de l'identité de leur propriétaire, qui les a généralement choisis avec soin, parfois dans une démarche "écolochic" ou en privilégiant certains types de matériaux (comme le wax, par exemple, un tissu africain pour les sachets réutilisables).
CY Cergy Paris Université : À quelles limites ou paradoxes les magasins offrant du vrac se heurtent-ils aujourd’hui ?
Élisa Monnot : Au-delà de ces modes d’appropriation, l’intérêt de notre article est aussi qu’il révèle qu’en vrac cette appropriation des fonctions de l’emballage n’est pas toujours chose facile et que, de ce fait, il peut y avoir une "mauvaise" appropriation de la part des individus. Notre recherche met donc en évidence une sorte de "face cachée" du vrac et, en l’occurrence, ses potentiels effets néfastes sur la santé, l’environnement ou l’exclusion sociale. Le vrac peut en effet conduire par exemple à des problèmes en termes d’hygiène ou de mésinformation, si les consommateurs n’étiquettent pas correctement leurs bocaux ou réutilisent un emballage pour un autre usage (une bouteille de jus de fruits en verre pour stocker de la lessive liquide ce qui peut évidemment être dangereux si tous les membres du foyer ne sont pas au courant de ce qu’elle contient). Nous montrons également toute l’ambivalence de la fonction environnementale du vrac (l’idée initiale de réduire la quantité de déchets d’emballage) puisqu’elle n’est pas toujours satisfaite. Les consommateurs sont en effet nombreux à acheter beaucoup de contenants, les fameux bocaux, et tout ce qui va avec pour les customiser (étiquettes, rubans, stylos pour faire du lettering, etc.). Leur priorité n'est pas tant de réutiliser d’anciens emballages mais plutôt d'en acheter de nouveaux, qui correspondent à leurs envies, mais qui sont souvent produits à l'autre bout du monde ! Il en résulte donc un gaspillage massif, au total opposé de ce que les achats en vrac sont censés véhiculer.
CY Cergy Paris Université : Pensez-vous que le vrac puisse s’étendre à grande échelle ou restera-t-il une niche ?
Élisa Monnot : Après avoir connu une période de forte croissance, le vrac a ensuite connu une période de flottement lors de la pandémie de covid-19. De nombreuses fermetures de magasins ont d’ailleurs eu lieu dans les années qui ont suivi. En grande distribution, le rayon est devenu un rayon parmi d’autres, alors même que certaines enseignes semblaient avoir beaucoup investi pour qu’il gagne en attractivité mais les consommateurs n’ont pas été suffisamment accompagnés. Certaines ont même fait marche arrière en le réimplantant comme il existait initialement. Ces derniers temps il semble que les choses s’améliorent et les innovations se multiplient. Les distributeurs devront s’adapter à l’évolution de la réglementation qui stipule qu’à l’horizon 2030 les magasins de plus de 400m² devront consacrer 20% de leur surface de vente de produits de grande consommation à la vente en vrac. Les perspectives sont donc plutôt encourageantes, mais il reste du chemin à parcourir.
CY Cergy Paris Université : Y a-t-il des aspects que vous aimeriez approfondir dans vos futures recherches sur ce sujet ? Quelle autre question souhaiteriez-vous explorer ?
Élisa Monnot : Le sujet de la consommation en vrac est complexe, mais surtout très inspirant pour des chercheurs comme nous car il s’agit à la fois d’un modèle qui n’est pas totalement nouveau (nos grands-mères le connaissaient déjà !) et, en même temps, qui nécessite d’être réinventé et adapté à nos modes de consommation actuels. De nombreuses questions restent donc en suspens, tant sur la manière d’accompagner les individus au mieux, pour qu’ils installent réellement ce mode de consommation dans leurs pratiques, que sur les leviers à activer en distribution comme en communication pour rendre cette transition réellement durable.
En savoir plus